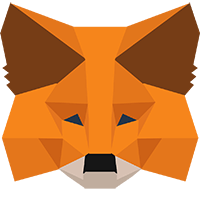Des Accords de Kyoto à la naissance du marché carbone
Tout commence avec le Protocole de Kyoto en 1997 : 37 pays industrialisés s'engagent à réduire collectivement leurs émissions de gaz à effet de serre (-5,2 % par rapport aux niveaux de 1990) entre 2008 et 2012. Pourtant, les États-Unis, alors responsables de 15 % des émissions mondiales, ne ratifient jamais l'accord, et le Canada s'en retire en 2011.
Aujourd'hui, plus de 190 pays participent aux discussions climatiques sous l'égide des Conférences des Parties (COP). L'Accord de Paris (2015) fixe un objectif mondial : limiter le réchauffement à 1,5 °C. Pourtant, il ne prévoit aucun mécanisme de sanction, laissant place à des manœuvres frauduleuses et à une mise en œuvre très inégale. Chaque pays fixe ses propres objectifs (NDC) et rend compte volontairement.
Le marché mondial du carbone, aujourd'hui valorisé à environ 1 300 milliards USD en 2023, connaît une croissance annuelle de 23 % depuis 2020. Mais les émissions globales, elles, atteignent un record : 58,1 gigatonnes CO₂e en 2022.
La taxe carbone - prélèvement obligatoire - introduit dans de nombreux pays, se présente comme un mécanisme pollueur-payeur destiné à freiner cette augmentation. Pourtant, la réalité du terrain montre un écart entre idéal et pratique.

Les failles et arnaques du système Carbone
Depuis son lancement, le marché carbone a permis de financer des projets évitant environ 6 milliards de tonnes CO₂e. Mais Europol estime que la fraude à la TVA sur les crédits carbone a coûté entre 5 et 10 milliards d'euros à l'Europe entre 2008 et 2009. Cette fraude est devenue emblématique d'une économie de la culpabilité : les consommateurs payent une surtaxe écologique tandis que des courtiers malveillants profitent du système.
Le Guardian a révélé en 2022 que 90 % des crédits carbone forestiers certifiés par Verra n'avaient apporté aucune réduction d'émissions vérifiable. De fausses promesses, des prétendus projets, des opérations fictives : autant d'arnaques qui alimentent la méfiance. Le greenwashing, la manipulation de la bonne conscience, font que le climat devient un terrain fertile pour la supercherie et les systèmes frauduleux.
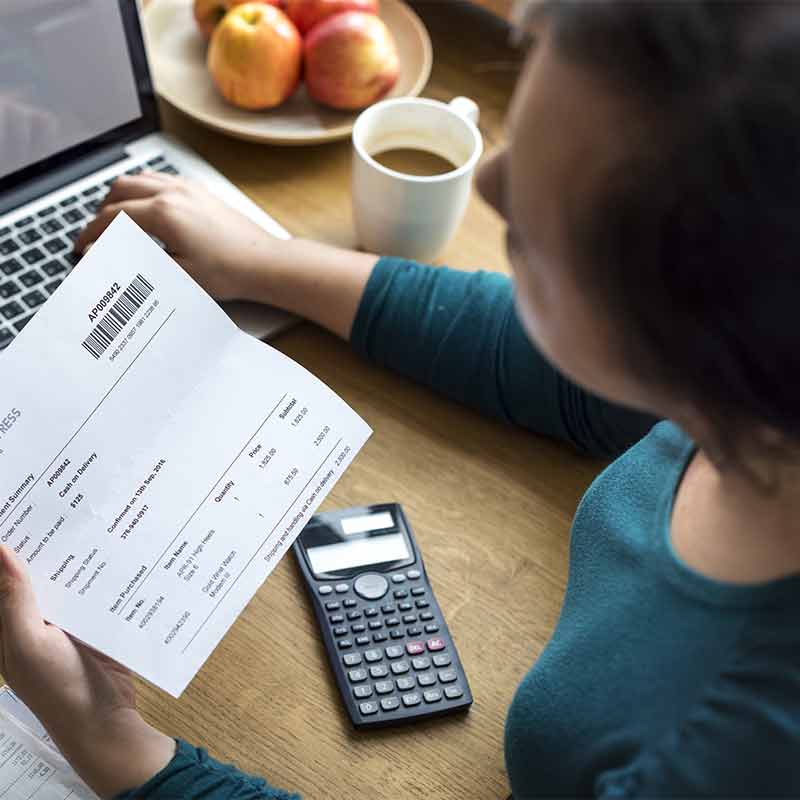
Une nouvelle taxe et un impôt déguisé
La taxe carbone française, mise en place en 2014, a augmenté les prix de 7 centimes/litre (essence) et 8 centimes/litre (diesel), rapportant environ 4 milliards €/an. Mais qui profite vraiment de ce prélèvement obligatoire ? Beaucoup y voient une pression fiscale supplémentaire, une contribution climat mal expliquée et une redistribution climatique insuffisante.
Les grandes entreprises, grâce à des pratiques douteuses comme le contournement des règles, réussissent souvent à minimiser leur facture. Le citoyen, lui, se sent pris au piège d'une taxe opaque et redoute l'évasion fiscale verte. Les signalements réglementaires augmentent, les enquêtes judiciaires se multiplient, et les émissions globales continuent de croître.

Fraudes et escroqueries, quand le climat devient un business
Le marché volontaire du carbone, valorisé à 2 milliards de dollars en 2023, est un véritable marché noir pour les escrocs. La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) américaine a observé une explosion des escroqueries liées au climat : faux certificats, inflation artificielle des chiffres, ventes pyramidales, crédits fantômes ou doublons. En Europe, l'ESMA signale une hausse de 45 % des alertes entre 2019 et 2022.
Des montages illégaux, des abus de confiance, des opérations délictueuses sont régulièrement dénoncés. En France, l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) a identifié plus de 20 sites frauduleux promettant des rendements verts exorbitants. La marchandisation du climat ouvre la porte à la captation de rente et à la rentabilisation abusive des objectifs initiaux.

Comment Prolifq propose une alternative équitable ?
Face à ces arnaques, Prolifq prône une approche différente. L'entreprise travaille à la conservation de 375 000 hectares de forêts tropicales, à la plantation d'espèces locales et à l'engagement de 2 500 familles. Chaque crédit carbone est certifié par un auditeur indépendant et inscrit sur la blockchain, garantissant zéro double comptabilisation et traçabilité complète.
Les investisseurs deviennent de véritables partenaires : ils financent la plantation de 1 million d'arbres d'ici 2030, génèrent des revenus durables pour les populations locales et participent à la création de 500 emplois directs. Le signal prix carbone devient ici une incitation à la transition, non plus une simple redevance environnementale.

Une nouvelle façon d'aborder l'économie carbone
Prolifq réconcilie impact réel et rentabilité : pas d'investissements bidons ni de promesses mensongères, mais des projets audités et vérifiables. Dans ce contexte, la taxe carbone cesse d'être une simple surtaxe pour devenir une opportunité : contribuer à un projet tangible, réduire son empreinte carbone, tout en évitant les arnaques du marché noir.
Avec une augmentation moyenne de 1,1 °C depuis l'ère préindustrielle, l'urgence climatique est indiscutable. La taxe carbone, qu'on le veuille ou non, fait partie de notre quotidien économique. Mais face aux escroqueries, aux supercheries et aux fraudes organisées, il est crucial de choisir des partenaires fiables. Prolifq offre une alternative qui transforme le capitalisme vert en un levier d'action vérifiable et éthique aussi bien pour le portefeuille que pour la planète.